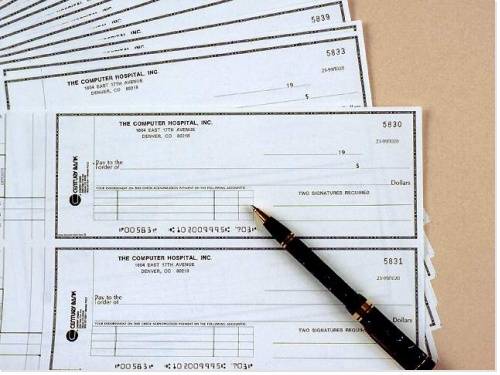L’historique du conflit remonte à Karl Marx avec l’idée de conflit social. Pour lui, le changement est issu de la lutte pour la propriété des moyens de production. Les rapports sociaux sont conflictuels (avantagés et désavantagés). Ce conflit est moteur de l’histoire. Le changement est le résultat des conséquences cumulées des diverses actions conflictuelles engagées par des classes sociales. L’intention est de construire un modèle théorique dont le but est double : expliquer la formation des groupes de conflit et rendre compte de l’action par laquelle ils entraînent des changements de structure (au sens où Parsons entend ce terme) dans le système social.
L’historique du conflit remonte à Karl Marx avec l’idée de conflit social. Pour lui, le changement est issu de la lutte pour la propriété des moyens de production. Les rapports sociaux sont conflictuels (avantagés et désavantagés). Ce conflit est moteur de l’histoire. Le changement est le résultat des conséquences cumulées des diverses actions conflictuelles engagées par des classes sociales. L’intention est de construire un modèle théorique dont le but est double : expliquer la formation des groupes de conflit et rendre compte de l’action par laquelle ils entraînent des changements de structure (au sens où Parsons entend ce terme) dans le système social.
Plus tard, la psychologie cognitive s’emparera de la notion de conflit au travers de différentes études, en voici quelques-unes.
- Jerome S. Bruner 1 précurseur de la psychologie cognitive étudie les stratégies mentales mises en place par les interactants pour résoudre un problème.
- Robert Siegler 2 l’un des pères de la théorie de l’évolution cognitive, propose une approche du développement en termes de traitement de l’information : processus des plus simples aux plus complexes, de détection, de perception, de mémorisation, de planification et de représentation des stimulis élémentaires de l’environnement. De nombreux concepts fondamentaux de la biologie évolutionniste comme la variation, l’autorégulation, l’hérédité, les changements adaptatifs semblent nécessaires pour étudier le développement cognitif.
- Petty et Caccioppo 3 élaborent début 1980, le modèle du changement d’attitude (ELM) qui offre une description des mécanismes mis en œuvre dans le traitement de l’information persuasive. Deux types de processus sont envisagés : central et périphérique. Ainsi une attitude qui résulte d’un traitement central est stable dans le temps, prédictive du comportement ultérieur de l’individu et peu sensible à la contre-persuasion alors qu’une attitude formée par traitement périphérique est beaucoup moins stable et prédictive des comportements.
- Kuklan 4 étudie les effets de crises organisationnelles pour les preneurs de décisions.
- Pérez, Mugny et Doise, au milieu des années quatre-vingt-dix se penchent plus en détail sur le conflit cognitif, qui fournit un cadre permettant de spécifier la nature des enjeux actualisés dans un rapport d’influence donné, ainsi que les dynamiques sociocognitives de résistance ou de changement qui en découlent.
Reprenons la notion de conflit social développé par Marx on y trouve quatre contributions fondamentales à la sociologie des conflits :
- tout d’abord, Marx a mis en lumière la permanence des conflits dans toute société ;
- en second lieu, Marx a compris que les conflits sociaux étant des conflits d’intérêts opposent nécessairement deux groupes, et deux groupes seulement. Car, dans la société, tout conflit d’intérêts se ramène en définitive à une opposition entre ceux qui ont intérêt à ce que se maintienne et se perpétue une situation dont ils bénéficient, et ceux qui ont intérêt ou croient avoir intérêt, à ce que la situation change ;
- troisièmement, Marx a parfaitement compris que le conflit est le principal moteur de l’histoire. Le conflit amène forcément des changements, à plus ou moins brève échéance. C’est dans et par l’opposition entre des groupes d’intérêts divergents que les structures sociales se transforment. Marx n’a pas su bien analyser de quelle façon le conflit engendre le changement, mais il a au moins posé le principe de l’explication du changement par le conflit ;
- enfin, par son analyse du changement par le conflit de classes, Marx a ouvert la voie à la recherche des facteurs structuraux du changement. On peut en effet distinguer deux classes principales de facteurs de changement : les forces exogènes, qui interviennent de l’extérieur du système social. C’est le cas, par exemple, des influences du milieu physique, du climat ; c’est aussi le cas des phénomènes de diffusion des techniques et des connaissances qu’ont étudiés les anthropologues. Les forces endogènes de changement sont engendrées par le système social lui-même ; elles naissent de son propre fonctionnement et dans sa structure même.
Représentation sociocognitive
La représentation sociocognitive, dénommée représentation individuelle ou cognitive par certains auteurs en sciences sociales, recouvre un champ très large d’applications (diffusion et assimilation des connaissances, développement individuel et collectif, définition de l’identité personnelle et sociale). Elle peut être considérée du point de vue cognitif, c’est-à-dire comme le produit et le processus d’une activité d’appropriation d’une réalité extérieure, mais aussi d’un point de vue social, au plan de l’élaboration psychologique et sociale de cette réalité. La représentation sociocognitive, en tant qu’acte de pensée, relie un sujet à un objet (processus d’objectivation). Il ne peut donc pas y avoir de représentation sans objet, c’est-à-dire sans une représentation mentale de l’objet qui ne porte la marque du sujet et de son activité. En d’autres termes, la représentation sociocognitive, quelle qu’en soit son expression, renvoie à un caractère constructif, créatif et autonome qui comporte une part de reconstruction, d’interprétation et d’expression du sujet 5. Elle constitue une forme de connaissance sur le monde, socialement élaborée dans l’interaction, à finalité sociale pratique.
Le complexe résistanciel en tant que représentation sociocognitive nécessite au moins l’interaction de deux interactants. Tout comme la représentation sociale, elle est composée d’une structure centrale, le noyau figuratif (l’image mentale qui contient et organise les contenus cognitifs de la représentation). Cette structure est activée par des processus sociocognitifs qui forment les contenus. Nous avons vu que ces processus en tant que règles d’actions, actes d’engagements sont déterminés par les compromis, les normes et les conventions. Elles sont mises en place par les interactants au sein d’une coopération. Ces processus s’appuient sur le schème cognitif en permettant l’unification de l’intentionnalité à la représentation. Le noyau central de la représentation sociocognitive est constitué d’une structure conceptuelle. Cette structure représente de manière tangible les contenus de la représentation de l’interactant et les contenus de l’ensemble des représentations de chacun des interactants partageant la sphère sociale et cognitive d’un interactant, et plus spécifiquement, les éléments ayant une forte résonance existentielle, telle que les valeurs, les croyances, les positions existentielles. Ceci s’explique par le fait que le noyau figuratif exerce cette fonction de génération de sens en tant que conscience de la conscience, (l’intentionnalité) capable de produire pour l’interactant, une signification qui soit compatible et cohérente avec sa propre conception existentielle voir ses univers de croyances. Ce noyau figuratif ou image mentale constitue l’élément fondamental de la représentation sociocognitive, car il détermine la signification et l’organisation des contenus représentationnels, par l’exercice de trois fonctions essentielles :
1. Une fonction génératrice de sens, par laquelle se crée ou se transforme la signification des différentes dimensions contenues dans la représentation, elle est prise de décision intra-personnelle. L’interactant génère du sens par l’intentionnalité, toute objectivation se complète dans les racines de la conscience.
2. Une fonction organisatrice de sens, car elle contraint la nature des liens qui unissent les contenus de la représentation. Elle est en ce sens, l’élément unificateur et stabilisateur de cette représentation. Entre la machine à générer du sens (l’intentionnalité) et la machine à organiser du sens (la représentation), existe la machine qui donne du sens au sens (le schème).
3. Une fonction distributrice de sens, lorsque l’ensemble des représentations lié à un contexte interne-externe a été créé puis organisé le sens prend sa place suivant un ordre préférentiel choisi par l’individu par un classement de priorité dépendant des schèmes existants. Chaque élément désormais organisé est diffusé, les particules de sens jusque-là agissant non consciemment jaillissent à la conscience en s’interconnectant les unes avec les autres. Il y a création, diffusion, rétablissement ou ordonnancement d’une nouvelle représentation qui va prendre la place de l’ancienne. Sans ce phénomène, l’individu resterait avec une représentation qui perdrait toute sa valeur, toute sa réalité, elle serait dépassée par le réel, l’individu serait lui-même en dehors du réel. Tout cet agencement se produit par le concours du phénomène de la résistance.
Création du complexe résistanciel
Ces fonctions (génératrice, organisatrice et distributrice de sens) exercées par le noyau figuratif résultent de l’activation de processus d’objectivation et d’ancrage qui forment les contenus représentationnels. Ces processus renvoient aux mécanismes cognitifs et sociaux qui constituent et régissent les agencements de ces contenus. Ils permettent de rendre compte de la manière dont l’activité sociocognitive transforme un conflit en représentation d’une manière autonome et réflexive. C’est par ces processus d’objectivation et d’ancrage que se construisent les représentations sociocognitives et que s’organise l’interdépendance de leurs éléments constitutifs (substances, contenus) ainsi que leurs conditions d’exercice.
Tout comme le complexe sociocognitif élaboré par Doise et Mugny, le complexe résistanciel est composé du processus d’objectivation qui est à l’origine de la formation et de l’agencement des connaissances relatives à un objet. L’objet est perçu, il prend une signification, l’objet devient sujet. A la différence du complexe sociocognitif qui se mesure par rapport à une prise de connaissance, le complexe résistanciel est dans un conflit de coopération, on peut dire un conflit d’ordre affectif. Il touche les parties les plus sensibles de l’individu, ses valeurs, ses croyances, ses émotions ce sur quoi il existe. Cette objectivation implique la mobilisation d’opérations imageantes et structurantes afin d’organiser de manière cohérente un ensemble de connaissances aux significations multiples. Ce processus d’objectivation est à l’origine de la formation du noyau figuratif constitué de contenus et de savoirs élaborés et agencés pour servir des besoins, des intérêts, des valeurs et des croyances ; ce noyau est donc subordonné à une finalité sociale, collective. Cette notion de finalité sociale est supportée par le processus d’ancrage qui porte sur l’enracinement social des contenus représentationnels présents dans le noyau, en leur conférant signification et utilité sociale. En mobilisant un principe de coopération, de compréhension d’autrui, le sujet confère à ces contenus représentationnels du sens et des utilités qu’il intègre dans son système de pensée. Il exprime ainsi l’investissement symbolique qu’il réalise dans la mise en œuvre de cette représentation.
1 Bruner J-S & al, Opinions & personality, Science Editions, 1956.
2 Siegler R, Intelligences et développement de l’enfant, De Boeck-Wesmael, 1999.
3 Petty R-E & Cacioppo J-T Attitudes and persuasion : Classic and contemporary approaches. Dubuque, Iowa:William Brown company publishers, 1983.
4 Kuklan & Hooshang, Managing crises : challenges and complexities, Advanced management journal, 1986.
5 Jodelet D, Représentations sociales : phénomènes, concepts et théorie, in Psychologie sociale, Moscovici S, Paris, PUF, Collection sociologie d’aujourd’hui, 1984.
Professeur associé ISC Paris
Gilles Teneau, La résistance au changement organisationnel, Préface Yvon Pesqueux, 2ème édition, l'Harmattan, 2011